| | | Rapport 2006 et modifications concours 2007 |  |
| | | Auteur | Message |
|---|
Lisette
Administratrice
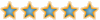

Nombre de messages : 1142
Localisation : Bretagne
Date d'inscription : 01/09/2005
 |  Sujet: Rapport 2006 et modifications concours 2007 Sujet: Rapport 2006 et modifications concours 2007  Mar 5 Déc - 21:04 Mar 5 Déc - 21:04 | |
| ANCIEN FRANÇAISRapport présenté par Marie-Madeleine CASTELLANI, ChristineFERLAMPIN-ACHER, Geneviève JOLY, Miren LACASSAGNE,Valérie MEOT-BOURQUIN2Dans la mesure où c’est désormais sur Internet que les candidats consultent les rapports desjurys de concours et qu’il est donc extrêmement facile d’avoir accès aux documents desannées antérieures, la commission d’ancien français tient à rappeler tout d’abord qu’il estindispensable non seulement de parcourir mais aussi de travailler ces rapports ; en particulier,les rapports des sessions 2004, 2005 et 2006 sont à considérer comme un tout. Ne lire que l’und’eux correspondrait à tronquer le propos du jury.En conséquence, nous ne rappellerons pas ici les indications bibliographiques données en2004, ni les conseils nés des résultats obtenus à la session 2005 ; ce dernier rapport nousparaît devoir impérativement être lu parce que, au-delà de la stricte description technique, ils’attache essentiellement, dans le but d’aider les candidats à organiser et leur préparationannuelle et leur copie de concours, à définir l’esprit du questionnaire proposé. Seule une justecompréhension de l‘épreuve est à même de fonder une juste appréciation du résultat visé.Pour cette raison également, le rapport sur la session 2006 définit à nouveau le cadre del’épreuve et les grands principes de notation ; le jury tient à souligner que les commentaires etindications qui suivent complètent pour une part ceux parus dans le rapport 2003. En effet, lescorrecteurs souhaitent attirer l’attention des candidats sur de possibles modifications mineuresdans les modalités d’interrogation. A titre transitoire, pour 2007, un choix sera toutefoisproposé pour les questions dans lesquelles un changement est apporté, permettant auxcandidats, s’ils le souhaitent, de conserver les modalités antérie ures.  L’ÉPREUVE? L’ÉPREUVE? Le cadre de l’épreuveEn deux heures trente, les candidats ont à traiter cinq questions :a) Traduction : Un passage d’une trentaine de vers – ou d’une longueur équivalente en prose –est donné à traduire. Traditionnellement, il s’agit d’un extrait du texte proposé au concours del’agrégation. En 2006, l’interrogation portait donc sur les oeuvres de Rutebeuf. Pour la session2007, le texte sera la Suite du Roman de Merlin.b) Phonétique : Depuis longtemps, les candidats sont invités à présenter l’histoire phonétiquecomplète de deux mots pris dans le texte ; l’étymon est donné. L’interrogation peut égalementporter sur l’étude d’une ou deux graphies, ou sur celle d’un phonème ; par là, dans laperspective qui est celle des candidats au CAPES qui enseigneront à des élèves de collège etde lycée, est notamment mis l’accent sur le passage de l’ancien français au français moderne,afin d’orienter l’exposé vers l’histoire de l’orthographe. A titre d’exemple, on peut envisagerdes questions du type « Commenter la graphie hoste (hostem) et comparer avec le françaismoderne », ou « Etudier et comparer les e de espee (spatham).c) Morphologie : La question comporte deux parties bien distinctes. D’une part, le candidatest appelé à classer et étudier en synchronie un corpus d’occurrences issues de l’extrait2 Marie -Madeleine CASTELLANI : traduction. – Christine FERLAMPIN-ACHER : phonétique. – GenevièveJOLY : morphologie. – Miren LACASSAGNE : syntaxe. – Valérie MEOT-BOURQUIN : vocabulaire (etcomposition d’ensemble du rapport).traduit ; d’autre part, il doit mener l’étude, en diachronie depuis le latin jusqu’au françaismoderne, de la formation et de l’évolution d’un paradigme courant.Ici comme en syntaxe, on rappellera que l’éventail des questions est large. Il convient de nepas faire l’impasse sur certaines questions au prétexte que pendant quelques années elles n’ontpas donné lieu à interrogation.Dans cette perspective, les deux sous-questions de morphologie ne seront pas nécessairementliées. Soit, comme en 2006, l’interrogation en diachronie porte sur une forme prise dans lecorpus étudié en synchronie (par exemple : étude des passés simples dans la première partie,étude de la formation et de l’évolution de prist dans la deuxième), soit elle en est dissociée(par exemple : étude des passés simples puis évolution d’un adverbe figurant dans le texte).On pourra également donner à étudier en diachronie un paradigme du texte (par exemple : unbel cheval). A nouveau, l’évaluation insistera sur le traitement du passage de l’ancien françaisau français moderne, trop souvent négligé dans ce type de question.d) Syntaxe : Si lors des dernières sessions du concours les questions de synthèse conduisant àétudier un corpus d’occurrences ont été privilégiées, une question ponctuelle, portant sur unetournure, un syntagme ou une phrase est envisageable. On peut alors interroger sur desexpressions, des structures à commenter dans des énoncés du type : « Faire toutes lesremarques syntaxiques sur… ».[/size][size=12]e) Vocabulaire : Etude de l’histoire sémantique de deux termes, rarement trois, choisis dansl’extrait à traduire. Une importance particulière doit être donnée à l’exploitation contextuelle.Le jury n’impose pas que les réponses suivent l’ordre du sujet ; cependant, il déconseillefermement le traitement éclaté d’une unique question (un mot de phonétique à la suite de latraduction, l’autre entre un peu de morphologie et un peu de vocabulaire par exemple). Cettepratique prive en effe t le développement de toute continuité. Elle interdit en outre au candidatde procéder par renvoi synthétique à des commentaires précédemment énoncés, ce quicontraint à des répétitions et donc à une perte de temps.Ainsi conçue, cette épreuve technique est fort gratifiante pour les candidats qui ont accomplile nécessaire effort de préparation.? Principes de notationa) La seule question systématiquement notée par soustraction est la version : chaque erreurcommise y entraîne une sanction. En conséquence, il n’est pas facile d’obtenir ici la notemaximale, même si sont valorisées les bonnes traductions.b) La note globale s’obtient par addition des notes partielles ; c’est dire combien il importe dene délaisser aucun des domaines d’interrogation, même si on a fait le choix d’en privilégiercertains.c) La qualité de la rédaction en une langue française correcte et élégante est directement priseen compte dans les questions de syntaxe et de vocabulaire (et à l’évidence dans l’épreuve deversion). Au-delà, parce que le professeur est le modèle des élèves et qu’en cela même ilenseigne, est sanctio nnée toute indigence dans la pratique de la langue française par un futurenseignant de lettres. Au fil des années, cette exigence prend tout son sens.d) Le jury attend des explications claires, sans imposer aucune théorie ni aucune écoleparticulière. Il se défie du verbiage, souvent supposé couvrir lacunes et manque de rigueur.? Compte rendu de la session 2006Dans l’ensemble, les résultats n’ont pas été bons. Le jury souhaite vivement qu’il s’agissed’un accident et invite les futurs candidats à tout mettre en oeuvre pour tirer avantage aumieux de cette discipline sans surprises et sans pièges.L’analyse des résultats paraît montrer en fait qu’un écart s’est creusé entre deux grands typesde candidats :D’une part, une masse importante de copies – et même importante au point d’en avoir été unesurprise pour les correcteurs - ont obtenu des notes inférieures à 2 sur 20. Il s ‘agit bien sûr decopies lacunaires mais on s’étonne que, prétendant devenir professeur de français, descandidats s’autorisent des erreurs telles : je reçu, un hôme pris la main, il m’accueilla ou jelui parla. L’énoncé de non-sens inquiète aussi : La trisyllabe yy devient tétrasyllabe… Quechaque lecteur de ces lignes médite sur le rapport aux mots que révèlent ces quelquesillustrations.Pourtant, avec un travail de préparation sérieux, les candidats peuve nt être assurés de voirleurs efforts récompensés, ce dont témoignent, en 2006 comme lors des sessions antérieures,des notes excellentes, supérieures à 18/20. Attribuées à des copies qui, sans être parfaites,prouvent qu’il est possible à un futur professeur de lettres d’étudier l’évolution de sa langueavec rigueur et élégance, dans le temps imparti le jour du concours, ces notes sont unencouragement donné aux futurs candidats à s’engager dans une préparation suivie etréfléchie. Le cadre de l’épreuveEn deux heures trente, les candidats ont à traiter cinq questions :a) Traduction : Un passage d’une trentaine de vers – ou d’une longueur équivalente en prose –est donné à traduire. Traditionnellement, il s’agit d’un extrait du texte proposé au concours del’agrégation. En 2006, l’interrogation portait donc sur les oeuvres de Rutebeuf. Pour la session2007, le texte sera la Suite du Roman de Merlin.b) Phonétique : Depuis longtemps, les candidats sont invités à présenter l’histoire phonétiquecomplète de deux mots pris dans le texte ; l’étymon est donné. L’interrogation peut égalementporter sur l’étude d’une ou deux graphies, ou sur celle d’un phonème ; par là, dans laperspective qui est celle des candidats au CAPES qui enseigneront à des élèves de collège etde lycée, est notamment mis l’accent sur le passage de l’ancien français au français moderne,afin d’orienter l’exposé vers l’histoire de l’orthographe. A titre d’exemple, on peut envisagerdes questions du type « Commenter la graphie hoste (hostem) et comparer avec le françaismoderne », ou « Etudier et comparer les e de espee (spatham).c) Morphologie : La question comporte deux parties bien distinctes. D’une part, le candidatest appelé à classer et étudier en synchronie un corpus d’occurrences issues de l’extrait2 Marie -Madeleine CASTELLANI : traduction. – Christine FERLAMPIN-ACHER : phonétique. – GenevièveJOLY : morphologie. – Miren LACASSAGNE : syntaxe. – Valérie MEOT-BOURQUIN : vocabulaire (etcomposition d’ensemble du rapport).traduit ; d’autre part, il doit mener l’étude, en diachronie depuis le latin jusqu’au françaismoderne, de la formation et de l’évolution d’un paradigme courant.Ici comme en syntaxe, on rappellera que l’éventail des questions est large. Il convient de nepas faire l’impasse sur certaines questions au prétexte que pendant quelques années elles n’ontpas donné lieu à interrogation.Dans cette perspective, les deux sous-questions de morphologie ne seront pas nécessairementliées. Soit, comme en 2006, l’interrogation en diachronie porte sur une forme prise dans lecorpus étudié en synchronie (par exemple : étude des passés simples dans la première partie,étude de la formation et de l’évolution de prist dans la deuxième), soit elle en est dissociée(par exemple : étude des passés simples puis évolution d’un adverbe figurant dans le texte).On pourra également donner à étudier en diachronie un paradigme du texte (par exemple : unbel cheval). A nouveau, l’évaluation insistera sur le traitement du passage de l’ancien françaisau français moderne, trop souvent négligé dans ce type de question.d) Syntaxe : Si lors des dernières sessions du concours les questions de synthèse conduisant àétudier un corpus d’occurrences ont été privilégiées, une question ponctuelle, portant sur unetournure, un syntagme ou une phrase est envisageable. On peut alors interroger sur desexpressions, des structures à commenter dans des énoncés du type : « Faire toutes lesremarques syntaxiques sur… ».[/size][size=12]e) Vocabulaire : Etude de l’histoire sémantique de deux termes, rarement trois, choisis dansl’extrait à traduire. Une importance particulière doit être donnée à l’exploitation contextuelle.Le jury n’impose pas que les réponses suivent l’ordre du sujet ; cependant, il déconseillefermement le traitement éclaté d’une unique question (un mot de phonétique à la suite de latraduction, l’autre entre un peu de morphologie et un peu de vocabulaire par exemple). Cettepratique prive en effe t le développement de toute continuité. Elle interdit en outre au candidatde procéder par renvoi synthétique à des commentaires précédemment énoncés, ce quicontraint à des répétitions et donc à une perte de temps.Ainsi conçue, cette épreuve technique est fort gratifiante pour les candidats qui ont accomplile nécessaire effort de préparation.? Principes de notationa) La seule question systématiquement notée par soustraction est la version : chaque erreurcommise y entraîne une sanction. En conséquence, il n’est pas facile d’obtenir ici la notemaximale, même si sont valorisées les bonnes traductions.b) La note globale s’obtient par addition des notes partielles ; c’est dire combien il importe dene délaisser aucun des domaines d’interrogation, même si on a fait le choix d’en privilégiercertains.c) La qualité de la rédaction en une langue française correcte et élégante est directement priseen compte dans les questions de syntaxe et de vocabulaire (et à l’évidence dans l’épreuve deversion). Au-delà, parce que le professeur est le modèle des élèves et qu’en cela même ilenseigne, est sanctio nnée toute indigence dans la pratique de la langue française par un futurenseignant de lettres. Au fil des années, cette exigence prend tout son sens.d) Le jury attend des explications claires, sans imposer aucune théorie ni aucune écoleparticulière. Il se défie du verbiage, souvent supposé couvrir lacunes et manque de rigueur.? Compte rendu de la session 2006Dans l’ensemble, les résultats n’ont pas été bons. Le jury souhaite vivement qu’il s’agissed’un accident et invite les futurs candidats à tout mettre en oeuvre pour tirer avantage aumieux de cette discipline sans surprises et sans pièges.L’analyse des résultats paraît montrer en fait qu’un écart s’est creusé entre deux grands typesde candidats :D’une part, une masse importante de copies – et même importante au point d’en avoir été unesurprise pour les correcteurs - ont obtenu des notes inférieures à 2 sur 20. Il s ‘agit bien sûr decopies lacunaires mais on s’étonne que, prétendant devenir professeur de français, descandidats s’autorisent des erreurs telles : je reçu, un hôme pris la main, il m’accueilla ou jelui parla. L’énoncé de non-sens inquiète aussi : La trisyllabe yy devient tétrasyllabe… Quechaque lecteur de ces lignes médite sur le rapport aux mots que révèlent ces quelquesillustrations.Pourtant, avec un travail de préparation sérieux, les candidats peuve nt être assurés de voirleurs efforts récompensés, ce dont témoignent, en 2006 comme lors des sessions antérieures,des notes excellentes, supérieures à 18/20. Attribuées à des copies qui, sans être parfaites,prouvent qu’il est possible à un futur professeur de lettres d’étudier l’évolution de sa langueavec rigueur et élégance, dans le temps imparti le jour du concours, ces notes sont unencouragement donné aux futurs candidats à s’engager dans une préparation suivie etréfléchie.
Dernière édition par Arthurverdi le Mar 26 Déc - 17:15, édité 2 fois | |
|   | | Lisette
Administratrice
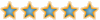

Nombre de messages : 1142
Localisation : Bretagne
Date d'inscription : 01/09/2005
 |  Sujet: Re: Rapport 2006 et modifications concours 2007 Sujet: Re: Rapport 2006 et modifications concours 2007  Mar 5 Déc - 21:04 Mar 5 Déc - 21:04 | |
| ? LES COMPOSANTES DE L’ÉPREUVE
I. Traduction
Traduire un texte médiéval au programme suppose une préparation sérieuse, qui ne saurait se
limiter à apprendre par coeur une traduction toute faite du commerce. La tentation était grande
cette année à cause de la présence d’une traduction juxtalinéaire dans l’édition du texte au
programme ; il n’en s’agit pas moins d’une attitude frisant la malhonnêteté intellectuelle
puisque le but de l’exercice et le rôle du jury sont de juger de la compréhension effective du
texte médiéval et de la capacité du candidat à en proposer une traduction personnelle. La
pratique est en ce sens proche de celle de la traduction d’un texte en langue étrangère. La
différence avec ces exercices, la présence d’un programme, a précisément pour but de
permettre une prise de connaissance approfondie de la grammaire, de la syntaxe, des
tournures du texte, et même, car il s’agit d’un ensemble cohérent, en l’occurrence une partie
importante des OEuvres complètes de Rutebeuf, des intentions et du style d’un écrivain. Cette
préparation, qui fait de la traduction une étape essentielle, doit permettre d’aborder
sereinement, à partir d’un texte parfaitement compris, les questions qui suivent.
Il est donc évident que l’étude du texte doit commencer suffisamment tôt et qu’une lecture
attentive du passage au programme en grammaire – qui en relève les traits morphologiques et
syntaxiques marquants et cherche à en élucider les difficultés – doit être achevée au moment
où commence la préparation universitaire. Mais, rappelons- le, il faut aussi lire l’ensemble de
l’oeuvre. C’était vrai pour Rutebeuf, ce sera aussi vrai et peut-être plus encore lors de la
session de 2007, où les candidats retrouveront une oeuvre romanesque, la Suite Merlin ; il
faudra pouvoir situer le passage proposé, en connaître le contexte et l’on évitera ainsi des
erreurs causées par l’ignorance portant sur l’action en cours, sur l’identité ou le statut des
personnages.
La préparation suppose l’apprentissage et la connaissance d’un certain nombre de faits
fondamentaux de langue, en morphologie et en syntaxe en particulier. Il est clair que cela peut
difficilement s’acquérir en quelques mois ; mais l’année du concours est normalement
l’aboutissement d’un cursus, au cours duquel l’étudiant aura acquis des connaissances que la
préparation finale doit rafraîchir et adapter au texte au programme. La connaissance de
quelques faits de langue simple (par exemple la déclinaison à deux cas) aurait évité des
erreurs d’analyse productrices de contre-sens : ainsi mes contes (v. 72) est un Cas sujet
singulier et non un pluriel, ce que confirmait de plus la forme du verbe anuit, la désinence -t
étant (y compris en FM) une désinence de singulier. De même au v. 81, pelerins, en
apostrophe, est également un singulier ; le texte ne parlait d’ailleurs que d’un seul voyageur.
Une pratique sérieuse de la langue médiévale permettait de reconnaître dans consout le
subjonctif présent du verbe conseillier qui avait lui- même ici le sens particulier, mais bien
attesté de « venir en aide », dans vox (v. 67), la P1 du passé simple du verbe vouloir, ou
encore dans jui (v. 72), celle du passé simple du verbe gesir, et enfin dans ou (v. 74) celle du
verbe avoir, trois formes dont l’identification était par ailleurs nécessaire pour la question de
morphologie. De même on ne pouvait comprendre le texte sans identifier des structures
courantes de l’ancien français comme por suivi d’un substantif, avec une valeur concessive
(por loier ne por promesse = « quoiqu’on leur donne ou qu’on leur promette » ou « même
contre de l’argent ou des promesses » ) ou le verbe a (v. 62, FM : « il y a »), forme
unipersonnelle du verbe avoir, que certaines copies semblent n’avoir même pas vue, ce qui a
produit des structures incorrectes, privées de proposition principale.
L’une des difficultés des poèmes de Rutebeuf, difficulté que la préparation du texte abordait
inévitablement très tôt, consiste dans les graphies, en particulier celle du son [s], qui peut
s’écrire s ou c : d’où par exemple dans le passage (v. 74) sel soir = cel soir, donc « ce soirlà
». La proximité du mot pitance a conduit certains candidats à voir dans ce sel, sans aucune
considération de l’impossibilité d’y voir grammaticalement un substantif, du « sel ». La même
difficulté graphique, inverse, se présentait aux vers 78 : ce ancor vit.. et 79 : c’il est mors, le c’
était un s’, et le ce un se, c’est-à-dire le subordonnant hypothétique se = si. La logique des
deux vers était très claire ; c’est l’alternative : « s’il vit encore » ou « s’il est mort ». Dans le
même vers 79, la forme l’arme (= l’âme) lue trop vite, a donné des traductions par « s’il
pleure » ou des absurdités comme « que Dieu ait son arme ». Là encore, la simple logique
aurait dû faire comprendre que dans ce contexte chrétien, ce qu’on peut souhaiter à un mort
c’est qu’il soit sauvé et donc que « Dieu ait son âme ». On voit combien des erreurs graves
auraient pu être évitées avec un peu d’attention et de bon sens. Il faut généralement se méfier
des calques, ainsi la conservation du mot pitance signalé plus haut n’était pas vraiment un
faux-sens mais eût été rendu avantageusement par « repas » ou « chère ».
Une fréquentation régulière du texte de Rutebeuf aurait dû faire prendre conscience qu’il
procède souvent par des « rimes équivoquées », faisant rimer des mots de forme semblable
mais de sens différents : ainsi vit (77, présent de vivre) et vit (78, passé simple de voir),
formes conservées en FM. De même, aux vers 69-70, les deux formes main. La première a été
généralement reconnue comme le mot « main », du FM, ce qui n’a pas empêché des
traductions parfois bizarres du vers – que signifie pas exemple : « moi qui n’ai pas d’autre
main » ? On sait que Rutebeuf se plaint d’être borgne, mais il n’a jamais dit être manchot ! –
en revanche, le main du vers 70 n’a pas été reconnu comme venant de mane, le matin (que
nous avons cependant conservé dans demain). Lui donner le sens de « main » a conduit à de
nombreux contre-sens (« moi qui n’ai pas la main levée », ou « moi qui ne peux lever la
main », traductions que ne justifiait absolument pas le simple déroulement logique du texte).
Les vers 70-71 (je, qui n’ai pas non d’estre main/leveiz) présentaient par ailleurs une structure
sur laquelle la question de syntaxe conduisait à s’interroger, où le pronom sujet je, exprimé,
est séparé du verbe jui, en l’occurrence par une relative, structure qui n’est plus conservée en
FM que dans : « je, soussigné, déclare...». Cela donnait donc : « moi, qui n’ai pas la réputation
d’être matinal, je couchai... »
L’ordre des mots enfin est encore fréquemment dans ce texte complément-verbe-sujet (le
sujet étant parfois omis : ainsi, au vers 69 : le chemin ting a destre main, chemin est le
complément du verbe tenir (au passé simple) et le vers signifie donc : « je pris (ou je suivis)
le chemin de droite (et non, comme on a pu trouver : « le chemin me tenait de la main droite,
ce qui est un non-sens !).
Enfin, la connaissance d’un certain nombre de faits de civilisation aurait évité quelques
erreurs grossières : ainsi preudons (v. 77) ne supporte pas le calque « prud’homme », le mot
ayant changé de sens en FM, mais doit être traduit par « homme de bien » ou éventuellement
« homme de valeur ». Marié et chef de famille (la meignie du v. 83), il ne peut être ici un
« ermite », sens que prenait ce mot dans la Queste del saint Graal. Mais il reste un homme
hospitalier, un hôte (le terme se trouvait au v. 85 : mon hoste), qui accueille en son osteil
(c’est-à-dire « chez lui », dans sa maison), un hôte non payant. L’osteil n’est donc ni un
« hôtel », ni une « auberge », qui sont, elles, payantes. Enfin, le voyageur est un pèlerin. C’est
sous ce nom qu’il est désigné et cela correspond au genre même du texte : songe de voyage
initiatique, la Voie d’humilité est un texte allégorique, un « pèlerinage de la vie humaine »
comme la littérature du XIIIe siècle en voit fleurir. Ce pèlerin voyage appuyé sur son bourdon
(c’est-à-dire son « bâton ») et avec son escharpe, en fait sa « sacoche », ce qui lui sert de
« sac ». Il suit un itinéraire que le texte détaille : il a pris le chemin de droite (a destre main,
littéralement celui qui est « du côté de la main droite »), ayant renoncé à un chemin dangereux
où l’attend la gent male et felonesse du v. 63 (le mot gent désignant un pluriel collectif
comme le montrent la désinence du verbe laissent au v. 65 et la reprise par il, CS Pluriel, sujet
de puissent, au v. 66) et, en chemin, il trouve une étape, à la cité de Pénitence, où on
l’interroge sur le chemin qu’il a suivi (le chemin qu’alei avoie, v. 89). Enfin, il s’inquiète du
chemin qu’il devra suivre et craint qu’il soit aussi difficile que celui de la première étape
(jornee, v. 93, où il était bon d’éviter le calque « journée »). Le texte présentait donc une unité
et une logique dans la perspective du voyage allégorique.
Ainsi, une préparation régulière, commencée suffisamment tôt et du bon sens doivent
permettre aux candidats d’aborder sereinement le déchiffrement du texte. Reste l’autre versant
de l’exercice, le passage à ce qu’il est convenu d’appeler la « langue-cible », le français
moderne. C’est aussi l’un des enjeux de cette épreuve de langue : vérifier la maîtrise du
français moderne, essentielle à de futurs professeurs de Lettres. Or, il reste encore à déplorer
bien des fautes matérielles qui ne sont pas toutes attribuables à l’émotion et qui de toutes
façons ne sont pas excusables. Outre l’orthographe (en particulier, trop souvent négligés sont
la ponctuation et les accents), ce sont des fautes de morphologie graves produisant des
barbarismes et une syntaxe incorrecte que l’on doit déplorer et qui sont sévèrement
sanctionnées. La correction grammaticale demande de l’attention et un travail régulier, mais
c’est une exigence essentielle de l’épreuve, comme d’ailleurs de l’ensemble des épreuves du
concours. C’est le moins que l’on doive attendre de candidats aux Capes de Lettres. Il va sans
dire que le jury est toujours heureux de lire de véritables traductions qui se libèrent des
calques et des structures anciennes pour produire un texte de français moderne correct voire
élégant, qui témoigne d’un maniement aisé par le candidat de sa propre langue. | |
|   | | Lisette
Administratrice
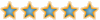

Nombre de messages : 1142
Localisation : Bretagne
Date d'inscription : 01/09/2005
 |  Sujet: Re: Rapport 2006 et modifications concours 2007 Sujet: Re: Rapport 2006 et modifications concours 2007  Mar 5 Déc - 21:05 Mar 5 Déc - 21:05 | |
| II. Phonétique
La question de phonétique portait encore, cette année, sur deux mots dont il fallait donner
l’évolution du latin au français moderne, noctem et hospitalem. Comme les années
précédentes, il s’agissait, après avoir donné la transcription du mot en latin, à l’époque du
texte et en français moderne, d’accentuer l’étymon et de donner la quantité des voyelles quand
cela était possible. Après cette première étape, sont attendues l’évolution du mot (avec des
repères chronologiques), la transcription de la prononciation supposée à chaque étape (dans
l’alphabet des romanistes ou dans l’API, même si celui-ci est peu utilisé par les manuels et les
candidats), et des exp lications concernant les divers phénomènes phonétiques en jeu.
Comme souvent, la question a été inégalement traitée. Les meilleures copies témoignaient
d’une maîtrise de la phonétique historique qui dépassait de loin la mémorisation aveugle de
dates et montrait une véritable compréhension des phénomènes. Une préparation régulière
permet d’aborder sans difficulté majeure ce type de question. On renverra les étudiants à
quelques ouvrages :
- G. Zink, Phonétique historique du français, Paris, PUF, 2ème éd, 1989
- N. Andrieux-Reix, Ancien et moyen français, exercices de phonétique, Paris, PUF, 1993
- G. Joly, Précis de phonétique historique du français, Paris, Armand Colin, 1999
- G. Joly, Fiches de phonétique Paris, Armand Colin, 1999
- M. Léonard, Exercices de phonétique historique, Paris, Nathan, 1999.
Quelques conseils :
- Ne pas oublier de noter les transcriptions phonétiques entre crochets.
- Il est nécessaire de prendre le temps d’accentuer correctement l’étymon. Une erreur
d’accentuation entraîne très souvent de graves erreurs dans l’évolution chronologique. Ne pas
oublier de donner la quantité des voyelles de l’étymon quand c’est possible.
- En ce qui concerne les datations, il faut privilégier la cohérence de la chronologie relative
(ainsi pour hospitalem, il était essentiel d’expliquer que le i devait tomber avant la
sonorisation des consonnes intervocaliques, puisque le t s’est maintenu).
- Signaler, au cours de l’évolution, le moment où est atteinte la prononciation supposée à
l’époque du texte.
- Ne pas hésiter à terminer une évolution par une ou plusieurs remarques sur les graphies, tant
médiévales que modernes, dans leur relation avec l’évolution phonétique.
- Ne pas hésiter à expliquer les phénomènes, sans se contenter de les nommer (ex : au sujet de
la fausse palatalisation dans noctem) | |
|   | | Contenu sponsorisé
 |  Sujet: Re: Rapport 2006 et modifications concours 2007 Sujet: Re: Rapport 2006 et modifications concours 2007  | |
| |
|   | | | | Rapport 2006 et modifications concours 2007 |  |
|
Sujets similaires |  |
|
| | Permission de ce forum: | Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
| |
| |
| |
